|
|
Le Maquis Camille |
|

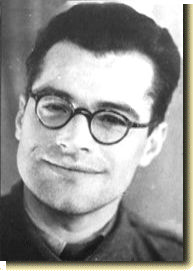
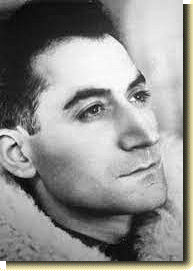 Le début du Maquis Camille se situe en novembre
1942 avec le parachutage d'armes à ses fondateurs. Ils ne sont initialement
que cinq : Paul Bernard qui prend le surnom de Camille et
Jean
Longhi
(Grandjean), rejoints par Jean-Baptiste Bastard (Jack), Robert
Bresson (Robert) et Louis Liebert (Jojo). Résistants
de la première heure en région parisienne, Camille et
Grandjean, qui se sont connus à l'école communale de Vincennes,
sont membres du Front National de Lutte pour l'indépendance de la
France. Après une série d'arrestation en 1941 ils décident
de quitter la région parisienne. En contact avec des Francs-Tireurs
de l'Yonne, il décident de se réfugier dans les bois du Morvan
pour continuer la lutte. Ils s'installent tout d'abord près de Quarré
les Tombes (Yonne) mais tout au long de son existence, de 1942 à 1944,
le Maquis ne cessera de se déplacer pour sa sécurité.
Le début du Maquis Camille se situe en novembre
1942 avec le parachutage d'armes à ses fondateurs. Ils ne sont initialement
que cinq : Paul Bernard qui prend le surnom de Camille et
Jean
Longhi
(Grandjean), rejoints par Jean-Baptiste Bastard (Jack), Robert
Bresson (Robert) et Louis Liebert (Jojo). Résistants
de la première heure en région parisienne, Camille et
Grandjean, qui se sont connus à l'école communale de Vincennes,
sont membres du Front National de Lutte pour l'indépendance de la
France. Après une série d'arrestation en 1941 ils décident
de quitter la région parisienne. En contact avec des Francs-Tireurs
de l'Yonne, il décident de se réfugier dans les bois du Morvan
pour continuer la lutte. Ils s'installent tout d'abord près de Quarré
les Tombes (Yonne) mais tout au long de son existence, de 1942 à 1944,
le Maquis ne cessera de se déplacer pour sa sécurité.
Les Maquisards de Camille, comme tous ceux du Morvan, vivent dans les bois, sous des tentes, été comme hiver, des lieux que l'occupant allemand évite de fréquenter. Les conditions sont très spartiates. Elles s'améliorent à partir de juillet 1944 avec l'installation dans le Camp des Goths entre le village de Saint Martin du Puy et le hameau de Plainefas. Là, les hommes sont logés dans des tentes faites de morceaux de parachutes mais aussi des baraquements en bois. Il y a un garage, un atelier de réparation, des dépôts d'armes, de munitions et de vivres. Il y a même un petit hôpital installé dans la ferme voisine. Les blessés sont soigné par deux médecins : Simone et Hélène. Les médicaments sont fournis par le pharmacien de Lormes, Paul Barreau, le Docteur Citron se chargeant de l'hospitalisation des cas les plus graves à l'hôpital de Lormes.
 Au fil du temps le Maquis se développe, le nombre
de Maquisards passant à 20 hommes et femmes en janvier 1944 puis à
81 en mai de la même année. Quelques épouses de Maquisards
rejoignent ou aident le Maquis comme Lucette, la sœur de Grandjean,
ou les infirmières France et Hélène. Les
activités consistent essentiellement en actions de sabotage comme la
destruction de la presse à fourrage de Lormes en octobre 1943. En avril
1944 une action de plus grande envergure permet la destruction d'une usine
de matériel électrique à Prémery. Ces attaques
ne sont possibles que grâce au parachutages d'armes, de matériel
et aussi d'argent. Ceux-ci sont trop peux nombreux au goût des Résistants
d'autant plus que souvent les containers se perdent ou sont détruits
lors de l'arrivée au sol. C'est pourquoi un partage est parfois réalisé
avec d'autres maquis de la région comme le Maquis Bernard à
Ouroux.
Au fil du temps le Maquis se développe, le nombre
de Maquisards passant à 20 hommes et femmes en janvier 1944 puis à
81 en mai de la même année. Quelques épouses de Maquisards
rejoignent ou aident le Maquis comme Lucette, la sœur de Grandjean,
ou les infirmières France et Hélène. Les
activités consistent essentiellement en actions de sabotage comme la
destruction de la presse à fourrage de Lormes en octobre 1943. En avril
1944 une action de plus grande envergure permet la destruction d'une usine
de matériel électrique à Prémery. Ces attaques
ne sont possibles que grâce au parachutages d'armes, de matériel
et aussi d'argent. Ceux-ci sont trop peux nombreux au goût des Résistants
d'autant plus que souvent les containers se perdent ou sont détruits
lors de l'arrivée au sol. C'est pourquoi un partage est parfois réalisé
avec d'autres maquis de la région comme le Maquis Bernard à
Ouroux.
 Conscient
de sa faiblesse, numérique en particulier,
Camille ne se risque pas à combattre frontalement
l'occupant, sauf s'il y est contraint ou à de rares exceptions.
C'est le cas le
12
juin 1944
avec l'attaque, sans l'accord de Grandjean, d'un convoi allemand à
Lormes qui fera
huit
morts.
Ce sera également le cas lors de l'attaque du Camp de Vermot
par les troupes allemandes les 26 et 27 juin suivie de terribles représailles
à Dun les Places.
Enfin du 12 au 16 août, lors de l'attaque de trois Maquis à Crux
la Ville par 800 soldats allemands, Camille et trois autres Maquis
participent à la défense et finissent par repousser l'agresseur.
Conscient
de sa faiblesse, numérique en particulier,
Camille ne se risque pas à combattre frontalement
l'occupant, sauf s'il y est contraint ou à de rares exceptions.
C'est le cas le
12
juin 1944
avec l'attaque, sans l'accord de Grandjean, d'un convoi allemand à
Lormes qui fera
huit
morts.
Ce sera également le cas lors de l'attaque du Camp de Vermot
par les troupes allemandes les 26 et 27 juin suivie de terribles représailles
à Dun les Places.
Enfin du 12 au 16 août, lors de l'attaque de trois Maquis à Crux
la Ville par 800 soldats allemands, Camille et trois autres Maquis
participent à la défense et finissent par repousser l'agresseur.
Après divers combats, début septembre Camille évacue le Camp des Goths et se replie à Lormes. Au cours de son existence Camille aura eu 17 blessés et 31 tués. En septembre 1954, c'est à dire dix ans après la dissolution de Camille, un monument en granit est édifié à Plainefas. Il porte l'inscription "A nos morts, Maquis Camille", la tête de gaulois en bronze symbole du Maquis, les noms des principaux lieux d'actions ainsi que 29 noms de Résistants et les dates 1942 - 1944.
|
|
